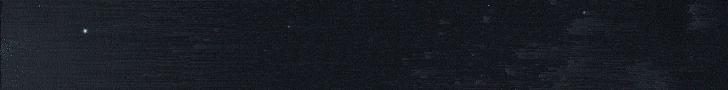Sobriété foncière
Les sénateurs sonnent la charge contre le ZAN

L’objectif de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021-2031 (par rapport à la période 2011-2021) serait reporté à 2034. © K. Ivshin / Adobe Stock
Le Sénat veut-il la peau du ZAN? Le zéro artificialisation nette, traduction de l’objectif de sobriété foncière issu de la loi climat et résilience, était déjà dans le viseur de l’éphémère Premier ministre Michel Barnier, qui avait exprimé en novembre dernier sa volonté «d’assouplir» le dispositif. «Changer le nom du ZAN, comme le propose la loi Trace, serait le symbole d’un nouvel état d’esprit et d’une nouvelle confiance», avait indiqué M. Barnier devant les sénateurs. Parmi ceux-ci, Dominique Estrosi-Sassone, sénatrice LR des Alpes-Maritimes et présidente de la commission des affaires économiques, qui a dévoilé le 12 mars dernier la proposition de projet de loi (PPL) «visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux», également nommée «PPL Trace». Selon la sénatrice, le ZAN est devenu «un casse-tête, voire un repoussoir», pour une majorité d’élus de terrain. «La trajectoire de sobriété foncière n’est pas remise en cause, a assuré Mme Estrosi-Sassone, mais elle peut freiner des projets portés par des communes.» La réponse doit donc passer par une approche «pragmatique», a-t-elle estimé, déclinée selon deux principes: «simplification et différenciation».
REPORT DE L’OBJECTIF INTERMÉDIAIRE À 2034
Co-rapporteur de la PPL, le sénateur LR du Puy-de-Dôme Jean-Marie Boyer, en est convaincu: «L’inquiétude des collectivités locales quant à leurs capacités de développement futures ne cesse de grandir». Première réponse proposée par les rédacteurs de la proposition de loi: l’abandon de l’objectif intermédiaire national de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021-2031 (par rapport à la période 2011-2021) et son report à 2034, au bon vouloir des régions. Selon ses promoteurs, cette approche plus souple doit permettre aux territoires de définir leur propre rythme, en fonction de leurs spécificités. L’objectif du zéro artificialisation nette en 2050 resterait en revanche inchangé. La PPL propose également de créer des exceptions, en excluant temporairement, jusqu’en 2036, certains projets prioritaires du décompte de l’artificialisation: implantations industrielles, constructions de logements sociaux dans les communes carencées au titre de la loi SRU et infrastructures de production d’énergie renouvelable.
Sur le plan du suivi des objectifs, il est également proposé de rebaptiser les «conférences régionales de gouvernance» en «conférences régionales de sobriété foncière», de modifier leur composition pour faire plus de place aux élus locaux (dont la représentation passerait de 60 à 75% des membres) et de leur attribuer de nouveaux pouvoirs. Elles pourraient désormais «contraindre la région à reconsidérer ses objectifs en matière de réduction de l’artificialisation» et se prononcer par «avis conforme sur la liste des projets d’envergure régionale». «Nous voulons inverser le processus, en faisant émerger les propositions des territoires et non en les imposant uniformément au niveau national», a expliqué Jean-Marie Boyer. «Nous portons le principe de différenciation territoriale en proposant un cadre adapté aux réalités et aux dynamiques territoriales», a renchéri la sénatrice centriste du Pas-de-Calais, Amel Gacquerre. Autre point saillant de la PPL, les échéances liées aux documents de planification et d’urbanisme seraient repoussées. Les documents régionaux devraient ainsi être modifiés d’ici août 2027, les schémas de cohérence territoriale (Scot) d’ici août 2028, et les plans locaux d’urbanisme et cartes communales à horizon 2029. Les sénateurs ont enfin adopté le maintien du calcul de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, les «Enaf», qui devaient, dans le cadre du ZAN, être remplacés en 2031 par des outils plus précis ayant notamment recours à l’intelligence artificielle.
Co-rapporteur de la PPL, le sénateur LR du Puy-de-Dôme Jean-Marie Boyer, en est convaincu: «L’inquiétude des collectivités locales quant à leurs capacités de développement futures ne cesse de grandir». Première réponse proposée par les rédacteurs de la proposition de loi: l’abandon de l’objectif intermédiaire national de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021-2031 (par rapport à la période 2011-2021) et son report à 2034, au bon vouloir des régions. Selon ses promoteurs, cette approche plus souple doit permettre aux territoires de définir leur propre rythme, en fonction de leurs spécificités. L’objectif du zéro artificialisation nette en 2050 resterait en revanche inchangé. La PPL propose également de créer des exceptions, en excluant temporairement, jusqu’en 2036, certains projets prioritaires du décompte de l’artificialisation: implantations industrielles, constructions de logements sociaux dans les communes carencées au titre de la loi SRU et infrastructures de production d’énergie renouvelable.
Sur le plan du suivi des objectifs, il est également proposé de rebaptiser les «conférences régionales de gouvernance» en «conférences régionales de sobriété foncière», de modifier leur composition pour faire plus de place aux élus locaux (dont la représentation passerait de 60 à 75% des membres) et de leur attribuer de nouveaux pouvoirs. Elles pourraient désormais «contraindre la région à reconsidérer ses objectifs en matière de réduction de l’artificialisation» et se prononcer par «avis conforme sur la liste des projets d’envergure régionale». «Nous voulons inverser le processus, en faisant émerger les propositions des territoires et non en les imposant uniformément au niveau national», a expliqué Jean-Marie Boyer. «Nous portons le principe de différenciation territoriale en proposant un cadre adapté aux réalités et aux dynamiques territoriales», a renchéri la sénatrice centriste du Pas-de-Calais, Amel Gacquerre. Autre point saillant de la PPL, les échéances liées aux documents de planification et d’urbanisme seraient repoussées. Les documents régionaux devraient ainsi être modifiés d’ici août 2027, les schémas de cohérence territoriale (Scot) d’ici août 2028, et les plans locaux d’urbanisme et cartes communales à horizon 2029. Les sénateurs ont enfin adopté le maintien du calcul de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, les «Enaf», qui devaient, dans le cadre du ZAN, être remplacés en 2031 par des outils plus précis ayant notamment recours à l’intelligence artificielle.
«CONSCIENCIEUSE DÉMOLITION»
Cette PPL a suscité des débats plutôt houleux lors de son examen en séance publique, le 13 mars. «Ce texte vise à casser le thermomètre, c’est un non-sens! Nous avons besoin d’avoir des outils qui permettent d’évaluer si nous allons dans la bonne trajectoire», a regretté Grégory Blanc, sénateur écologiste de Maine-et-Loire. Son homologue de Loire-Atlantique, Ronan Dantec (Ecologistes), a fait part de sa stupéfaction: «Comment est-on passé de l’amélioration de la loi à sa consciencieuse démolition?» Cinq jours plus tard, lors du vote de la PPL, le 18 mars, la colère de l’élu de l’Ouest n’était pas retombée: «Cette loi ZAN 3 est une loi de posture et de surenchère de la droite nationale, a-t-il cinglé, une loi qui est à contretemps des élus territoriaux, dont la plupart sont en passe d’adopter leur Sraddet [schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires].» Pour le sénateur écologiste, qui a rappelé que les représentants de la Fnsea et de la Fédération des Safer (société d’aménagement foncier et d’établissement rural) avaient, lors de leurs auditions, fait part de leur opposition au texte, l’intention est claire: «Il fallait en finir avec le ZAN».
Autre son de cloche du côté du groupe des «indépendants» (Horizon, Parti radical, Divers droite), par la voix du sénateur de la Loire Pierre-Jean Rochette: «Ce texte est une bouffée d’air frais pour les élus locaux», s’est-il au contraire félicité, tout en réfutant l’idée que les assouplissements proposés puissent constituer «une porte ouverte à une artificialisation effrénée». L’élu Rassemblement national de Seine-et-Marne Aymeric Durox s’est pour sa part félicité du coup d’arrêt donné par cette PPL à «l’écologie punitive», la loi climat et résilience étant de son point de vue «l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire». Coauteur du texte, le sénateur du Nord Guislain Cambier (Centristes) s’est réjoui que les sénateurs fassent le choix de «redonner la main aux élus locaux […] en choisissant la confiance et le contrat». «Prétendre que nous détricotons l’objectif du zéro artificialisation nette serait malhonnête et mensonger», a-t-il lancé à l’opposition, se disant «confiant quant à la suite du chemin parlementaire du texte». Adopté au Sénat par 260 voix contre 17, celui-ci doit désormais être examiné par l’Assemblée nationale.
Cette PPL a suscité des débats plutôt houleux lors de son examen en séance publique, le 13 mars. «Ce texte vise à casser le thermomètre, c’est un non-sens! Nous avons besoin d’avoir des outils qui permettent d’évaluer si nous allons dans la bonne trajectoire», a regretté Grégory Blanc, sénateur écologiste de Maine-et-Loire. Son homologue de Loire-Atlantique, Ronan Dantec (Ecologistes), a fait part de sa stupéfaction: «Comment est-on passé de l’amélioration de la loi à sa consciencieuse démolition?» Cinq jours plus tard, lors du vote de la PPL, le 18 mars, la colère de l’élu de l’Ouest n’était pas retombée: «Cette loi ZAN 3 est une loi de posture et de surenchère de la droite nationale, a-t-il cinglé, une loi qui est à contretemps des élus territoriaux, dont la plupart sont en passe d’adopter leur Sraddet [schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires].» Pour le sénateur écologiste, qui a rappelé que les représentants de la Fnsea et de la Fédération des Safer (société d’aménagement foncier et d’établissement rural) avaient, lors de leurs auditions, fait part de leur opposition au texte, l’intention est claire: «Il fallait en finir avec le ZAN».
Autre son de cloche du côté du groupe des «indépendants» (Horizon, Parti radical, Divers droite), par la voix du sénateur de la Loire Pierre-Jean Rochette: «Ce texte est une bouffée d’air frais pour les élus locaux», s’est-il au contraire félicité, tout en réfutant l’idée que les assouplissements proposés puissent constituer «une porte ouverte à une artificialisation effrénée». L’élu Rassemblement national de Seine-et-Marne Aymeric Durox s’est pour sa part félicité du coup d’arrêt donné par cette PPL à «l’écologie punitive», la loi climat et résilience étant de son point de vue «l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire». Coauteur du texte, le sénateur du Nord Guislain Cambier (Centristes) s’est réjoui que les sénateurs fassent le choix de «redonner la main aux élus locaux […] en choisissant la confiance et le contrat». «Prétendre que nous détricotons l’objectif du zéro artificialisation nette serait malhonnête et mensonger», a-t-il lancé à l’opposition, se disant «confiant quant à la suite du chemin parlementaire du texte». Adopté au Sénat par 260 voix contre 17, celui-ci doit désormais être examiné par l’Assemblée nationale.
« Un besoin de stabilité »
La Fédération nationale des Scot, la Fédération des parcs naturels régionaux et l’Institut de la transition foncière (dont l’Ordre des géomètres-experts est adhérent, Ndlr) ont publié le 17 mars un communiqué dénonçant la loi Trace, jugée «inutile et risquée» pour les collectivités. «La dynamique est lancée, les démarches déjà bien avancées dans les territoires. Toute nouvelle modification […] mettrait en grande difficulté la majorité des territoires qui ont déjà intégré la trajectoire de sobriété foncière ou sont en cours de le faire. Elle aggraverait considérablement les difficultés des élus à rendre compréhensible cette réforme auprès de nos concitoyens, notamment ceux qui ont déjà participé aux consultations publiques», observent les auteurs du communiqué. Plutôt que de légiférer à nouveau, ils demandent aux parlementaires de se concentrer sur «les vraies priorités»: fiscalité, financement du ZAN et accompagnement des collectivités.