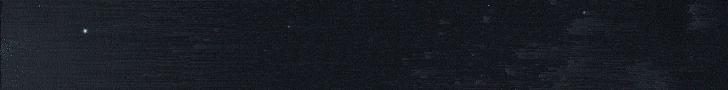Le projet de loi Trace face aux réalités locales

«Plus de trace de l’objectif zéro artificialisation nette?», s’interrogent avec une pointe d’humour, quatre chercheurs en urbanisme et écologie, dans une tribune parue sur le site theconversation.com (1). Au-delà du jeu de mots, la proposition de loi sénatoriale du 18 mars, qui supprime l’acronyme ZAN et le remplace par le dispositif «trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les édiles» (Trace), interpelle de nombreux professionnels et élus sur les conséquences locales de ce changement de paradigme en matière de sobriété foncière. «Cette proposition de loi Trace a été ainsi rédigée, car le ZAN est dans une situation d’impasse, rejeté par un grand nombre de territoires, notamment ruraux. Soyons factuels et réalistes: le temps d’action pour atteindre l’objectif de 50% en 2031 est insuffisant au regard de l’inertie des démarches d’élaboration ou de l’évolution des documents de planification (4 à 6 ans de travail) et de leur délai d’application. Un objectif irréaliste est un objectif contre-productif», note Timothée Hubscher dans un article publié sur urbanisme.fr, directeur de la planification et de la résilience des territoires du groupe Scet (filiale de la Caisse des dépôts spécialisée dans le conseil aux collectivités), qui considère que l’impact maximum des nouvelles règles du jeu serait de «30.000ha consommés en plus par rapport à ce qui était attendu par la loi climat et résilience».
En achetant le numéro correspondant à cet article (Numéro 2235), vous recevrez la version imprimée et aurez accès immédiatement à l'ensemble de son contenu en ligne.
Je m'abonne (11 numéros) / J'achète ce numéro Je me connecte