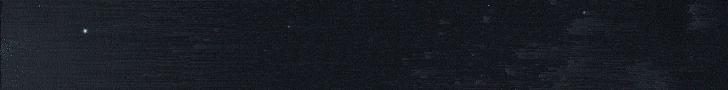La biodiversité sous l’œil des satellites

La biodiversité réunit l’ensemble des êtres vivants – divers par nature après une évolution de près de quatre milliards d’années – dans une définition englobant les interactions entre êtres vivants et les écosystèmes qui les abritent. Une notion souvent mal comprise, car la possible disparition de quelques espèces emblématiques comme le panda ou l’ours polaire attire beaucoup plus l’attention que celle, tout aussi probable, de milliers d’espèces d’insectes. Après la Seconde Guerre mondiale, le développement de l’agriculture, de l’industrie, des transports, du tourisme et d’autres secteurs de l’économie entraîne l’extinction d’un grand nombre d’espèces vivantes. Au point que l’on évoque déjà la sixième extinction massive (la cinquième et dernière en date, survenue à la fin du crétacé et probablement causée par un astéroïde, ayant entraîné la disparition de la plupart des dinosaures). Alors que le phénomène s’intensifie, le terme de biodiversité apparaît dans les années 1980 puis s’invite au sommet de Rio (1992) où est signée la convention sur la diversité biologique. La biodiversité devient alors un enjeu politique et des décisions sont prises pour la préserver, voire la régénérer. Des objectifs qui apparaissent rapidement en décalage avec une mondialisation devenue galopante.
Pour accompagner les efforts consentis, il est nécessaire de quantifier la biodiversité. Mais il ne s’agit pas là d’une variable qu’un instrument de mesure pourrait déterminer de façon quantitative, et elle n’a de sens que sur une certaine étendue. Deux approches indirectes sont néanmoins envisageables, combinant les observations de terrain avec la vision globale qu’offrent les satellites. La première est une mise en œuvre classique de la télédétection consistant à analyser les variations spatiales et temporelles des écosystèmes pour peu qu’on utilise un capteur sensible à ces changements. L’autre approche consiste à définir un ensemble de variables dont la connaissance permet de caractériser la biodiversité. Un consensus s’est établi au niveau international dans le cadre du réseau GEO BON. Un BON (Biodiversity observation network) est un réseau d’observations, spécialisé dans une région ou dans un écosystème, organisé en tenant compte d’un protocole et d’un ensemble de variables appelé EBV (Essential biodiversity variables). Certaines de ces variables, liées notamment au fonctionnement des écosystèmes (production de biomasse végétale sous l’effet de la photosynthèse, phénologie, perturbations) et à leur structure horizontale et verticale, sont directement observables sur le terrain ou par satellite.
UN ENJEU POUR LES MISSIONS SPATIALES
Compte tenu du potentiel de l’observation spatiale, non pour détecter ou identifier des êtres vivants mais pour reconnaître des écosystèmes et suivre leur variation au cours du temps, la biodiversité est un des enjeux des missions spatiales, au même titre que le réchauffement climatique. La conférence europénne BioSpace25 qui vient de se tenir à Rome a réuni les agences spatiales et les acteurs de la recherche et de la gestion de l’environnement pour évaluer la contribution des systèmes d’observation et orienter les développements technologiques vers une meilleure connaissance de la biodiversité, notamment en ciblant la mesure des EBV.
Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour comprendre le lien entre la diversité biologique et les indicateurs mesurés depuis l’espace. Cependant, les facteurs qui menacent la biodiversité sont d’originement essentiellement anthropiques (étalement urbain, usage de pesticides et réchauffement climatique, pour ne prendre que ces quelques exemples) et toutes ces recherches n’ont de sens que si des décisions sont prises et respectées en faveur d’une limitation de ces facteurs.